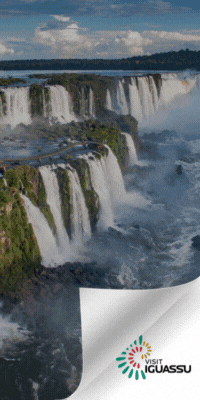Dans un cercle de musique et de mouvement, deux silhouettes se répondent sans jamais se toucher. Entre esquives, sauts et pirouettes, la capoeira raconte une histoire où le corps devient mémoire. Cet art mêlant danse, combat et chant est né au Brésil comme un acte de résistance et d’identité. Aujourd’hui encore, son énergie palpite dans les rues, les écoles et les plages du pays.
Des plantations coloniales à la reconnaissance mondial

Née dans le Brésil colonial, la capoeira est le fruit du métissage culturel entre les peuples africains réduits en esclavage. Dans les plantations de canne à sucre et les ports, ces hommes et ces femmes ont uni danses, rythmes rituels et techniques de défense pour préserver leur culture et leur dignité.
Longtemps réprimée après l’abolition de l’esclavage en 1888, elle a survécu dans les communautés afro-descendantes, notamment à Salvador de Bahia. Grâce à des maîtres tels que Mestre Bimba et Mestre Pastinha, elle a trouvé une nouvelle légitimité, jusqu’à être inscrite en 2014 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.
Dans les années 1990, la capoeira a connu une visibilité mondiale grâce au film Only the Strong, réalisé par Sheldon Lettich, qui fit découvrir au grand public sa musicalité et son élégance. La pop culture a amplifié ce phénomène avec le personnage d’Eddy Gordo dans la célèbre saga de jeux vidéo Tekken qui a introduit la capoeira dans l’imaginaire collectif de toute une génération. Aujourd’hui cette pratique est enseignée dans plus de 150 pays, preuve qu’un art né de la résistance peut devenir un langage universel.
L’art du jeu et de la roda

Au cœur de la capoeira, il y a la roda (cercle), cercle vivant où tout prend sens. Le berimbau – un arc musical qui donne le rythme – donne le rythme, accompagné du pandeiro (tambourin), de l’atabaque (tambour) et de l’agogô (cloche double en métal). Autour, les voix s’élèvent, chantant les maîtres et l’histoire. La ginga, mouvement de base, garde le joueur en perpétuel mouvement – jamais figé, toujours prêt à attaquer ou à esquiver.
Chaque geste est un dialogue : un appel, une réponse, une improvisation. La capoeira n’est pas un affrontement, mais un langage du corps où se mêlent créativité, stratégie et respect mutuel.
Styles et écoles
- Capoeira Angola : héritière des racines africaines, elle conserve un rythme lent, des mouvements bas et un jeu au ras du sol, où la ruse l’emporte sur la force.
- Capoeira Regional : créée dans les années 1930, elle a intégré des éléments d’arts martiaux et un système d’enseignement structuré. Elle a introduit les acrobaties, les uniformes blancs, les niveaux de maitrise et un système d’enseignement structuré.
- Capoeira contemporaine : fusion des styles Angola et Regional, elle allie technique et spectacle, s’adaptant à de nouveaux contextes tout en préservant l’équilibre entre art, combat et musique.
Un art partagé avec le monde
De Salvador à Recife, en passant par Rio de Janeiro, la capoeira rythme la vie des places et des plages. Dans certaines destinations comme Arraial d’Ajuda, des écoles proposent des initiations aux voyageurs, invitant à découvrir la philosophie de cet art plus qu’à apprendre une simple technique.
Ceux qui regardent une roda y voient un spectacle. Ceux qui y entrent découvrent un langage.
Parce qu’au fond, la capoeira est bien plus qu’un art martial ou une danse : c’est la preuve que l’histoire, même lorsqu’elle est douloureuse, peut se transformer en beauté, en rythme et en liberté.
Photos : Visit Brasil | Renata Spinelli