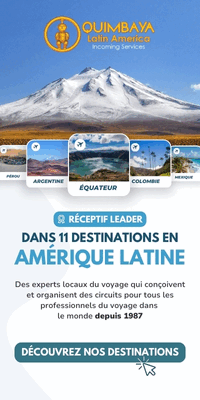Quand on imagine une « battle de danse », on pense peut-être immédiatement à la scène d’ouverture mythique de West Side Story, où les Jets et les Sharks expriment leur rivalité par le mouvement. Pourtant, bien avant les chorégraphie cinématographique, une autre forme de duel dansé existait déjà dans les hauteurs du Pérou : la Danza de las Tijeras (Danse des Ciseaux), aussi appelée danzaq.
Née dans les Andes, cette danse n’est pas qu’un affrontement spectaculaire : c’est une épreuve de résistance, d’agilité et de dévotion. C’est une danse qui défie le corps, mais qui honore également le savoir ancestral et témoigne d’un lien profond avec la terre.
Une danse venue de loin
Ses origines remontent à l’époque préhispanique, au sein du peuple Chankas, où elle accompagnait les fêtes agricoles dédiées à Pachamama, la Terre-Mère. À cette époque, les danseurs étaient appelés tusuq laykas : des figures hybrides entre prêtres et guérisseurs, capables aussi de prédire l’avenir et d’entrer en contact avec les esprits.
Avec l’arrivée des Espagnols, la tradition ne disparaît pas : elle se transforme. Les danseurs acceptent de se produire lors des fêtes chrétiennes, tout en préservant l’essence de leur spiritualité.
Selon les régions andines, cette expression prenait différents noms : danzaq à Ayacucho, saqras à Apurímac, gala à Huancavelica. Le terme « Danse des Ciseaux » ne s’impose qu’en 1962, avec la publication de La agonía de Rasu Ñiti de l’écrivain José María Arguedas. Depuis, ce nom est resté associé à cette forme artistique, en référence à son instrument central : deux lames métalliques qui, frappées l’une contre l’autre, produisent un son caractéristique. Ces pièces, semblables à des ciseaux sans pivot, marquent le rythme d’une danse aussi technique que spirituelle, véritable patrimoine vivant.
Une joute qui défie l’endurance
Cette danse ne se joue pas : elle se survit. Les duels, ou atipanakuy, peuvent durer des heures. Deux groupes se défient dans un duel chorégraphié où chaque mouvement tente de surpasser le précédent. Agilité, force, créativité, et endurance physique et mentale sont mises à l’épreuve. Aucun jury, la règle est simple : tenir, oser, surpasser.
Le son métallique des ciseaux devient hypnotique, accompagnant la harpe et le violon, marquant chaque étape d’une chorégraphie à la fois codifiée et libre :
- Marche : salut au public et hommage au saint patron.
- Répétition : début de la confrontation entre les danseurs.
- Pukllas : le son des ciseaux devient central.
- Tuku Menor : pas rapides, souvent improvisés.
- Tuku Mayor : figures acrobatiques et défis physiques.
- Wañuy Unccuy : geste solennel du retrait de chapeau.
- Golpes : démonstration de virtuosité technique et de maitrise du rythme.
- Agua e Nieve : provocation rituelle envers l’adversaire.
- Choladas : climax de la compétition, jusqu’à l’abandon de l’un des deux.
- Épreuve de courage : marcher sur du verre, jouer avec le feu.
- Épreuve de sang : acte ultime de sacrifice et de pouvoir spirituel.
Un art total : costume, rituel, identité
La tenue du danseur ne passe pas inaperçue. Véritable œuvre d’art textile : vestes brodées de fils dorés et argentés, miroirs scintillants, franges animées par le mouvement. Coiffé de chapeaux décorés, le danzaq impressionne par son allure.

Mais ce costume est bien plus qu’un apparat festif. Il symbolise le pouvoir et la connexion spirituelle. Selon les croyances populaires, les danzaq ne doivent pas entrer dans les églises : leur force viendrait de pactes sacrés qui ne relèvent pas toujours du divin, du moins selon la tradition chrétienne. Cette ambivalence entre sacré et profane, entre monde indigène et occidental, est l’essence même d’une danse incarnant la dualité andine : une compétition saine entre forces opposées.
Un patrimoine qui continue de danser
Classée Patrimoine culturel de la Nation en 1995 et inscrite au Patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010, la Danse des Ciseaux reste bien vivante. Elle se transmet de maître à élève, de fête en concours, d’un souffle à l’autre.
On peut l’admirer à Huancavelica, berceau du genre, mais aussi à Ayacucho ou Apurímac lors des carnavals et fêtes patronales. Chaque représentation est unique, car elle porte l’empreinte du danseur. Mais toutes dégagent la même intensité : celle d’un acte de foi, d’un dialogue entre le ciel et la terre.
La Danse des Ciseaux ne se comprend pas seulement avec les yeux : elle se ressent. Par l’émerveillement, le respect, les frissons que provoque chaque saut défiant la gravité, elle nous relie à une histoire transmise de génération en génération. Et peut-être aussi une raison de plus de mettre le cap sur le Pérou pour éprouver, sur place, la puissance intacte de traditions qui ne se contentent pas de survivre, mais continuent de se réinventer dans le souffle du présent.
Photos : Rafael Cornejo | PromPeru